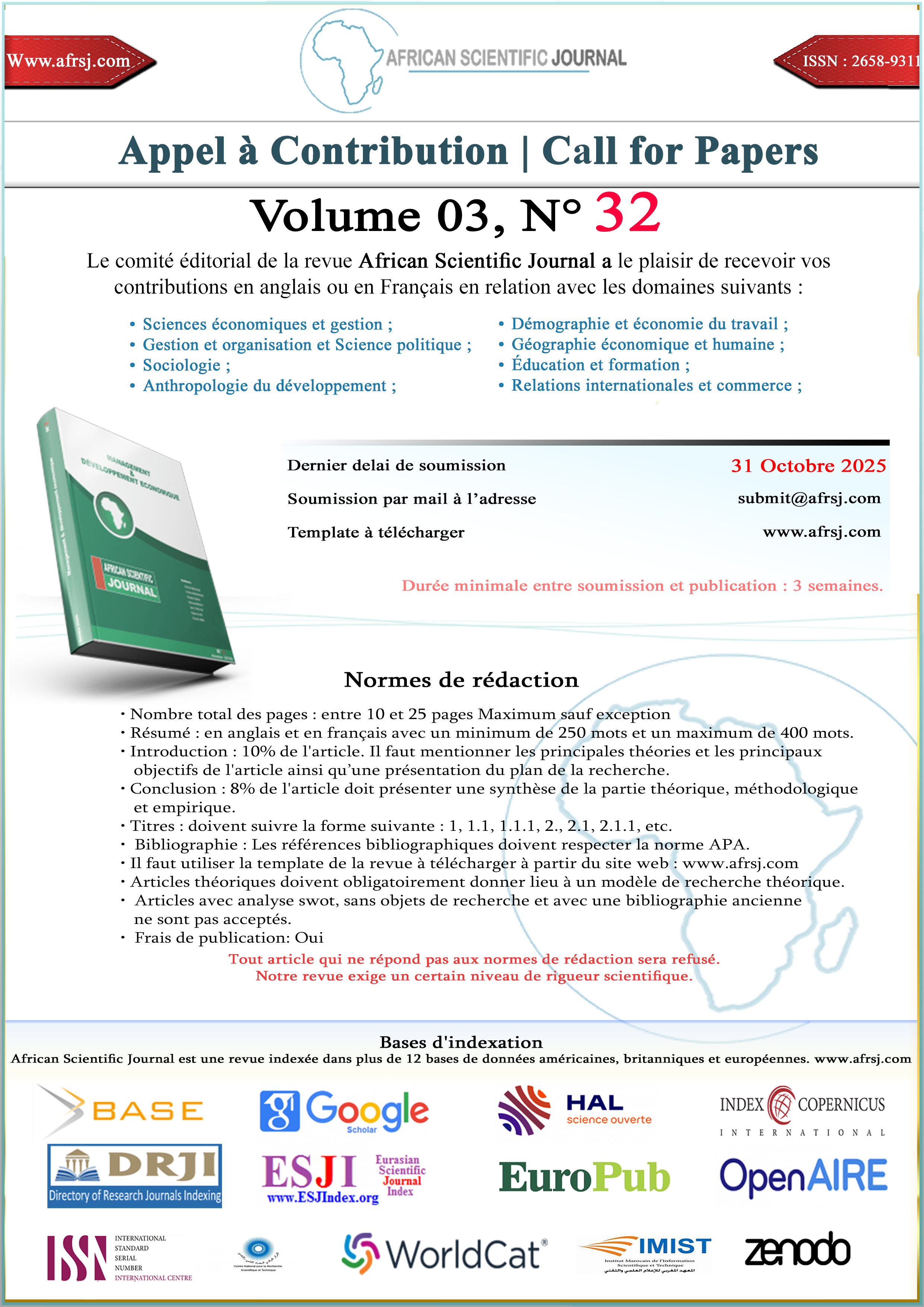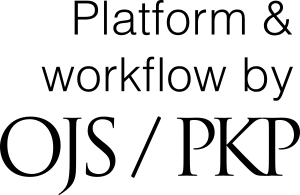Mobilité circulaire des travailleuses rurales et autonomisation locale des femmes : Le cas de la plaine du Loukkos
Mobilité circulaire des travailleuses rurales et autonomisation locale des femmes : Le cas de la plaine du Loukkos
DOI :
https://doi.org/10.5281/zenodo.17280232Résumé
Résumé
Cet article se focalise sur l'étude et l'analyse des implications et des risques liés à la mobilité circulaire des travailleuses agricoles qui partent en Espagne sur leur territoire local d’origine. La question de mobilité n’est pas très répandue, il y a des rapports et des recherches qui ont abordé le sujet mais il existe un manque de recherches approfondies à ce propos, Notamment concernant l’incidence socioéconomique de cette expérience de mobilité à l’échelle internationale, Et le lien de cause à effet l’épanouissement socioéconomiques des femmes travailleuses, et leur « empowerment socio-économique ». Cette dimension s’avère peu analysée, d’où l’intérêt de cet article qui vise essentiellement à explorer cette dimension relative au renforcement de leur « empowerment » dans la contribution au développement socio-économique et environnemental de leur communauté, Cette recherche fixe comme objectif à combler cette lacune en examinant attentivement les liens entre les différentes variables. Cet article examinera comment la mobilité saisonnière des travailleuses agricoles de Larache, catalysée par la pression agro-climatique et la demande horticole européenne, devient à la fois filet de sécurité économique et levier potentiel de développement territorial local.
Sur le plan normative, l’Agenda 2030 confère à cette question une visibilité nouvelle : la cible 8.8 des Objectifs de développement durable appelle à « protéger les droits des travailleurs migrants, notamment des femmes ». Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) de 2018 consacre par ailleurs un principe transversal de sensibilité au genre, invitant les États à lever les restrictions discriminatoires pesant sur les trajectoires féminines8. Ces engagements s’articulent avec les Conventions 97 et 143 de l’OIT, ainsi qu’avec la Convention CEDAW, qui reconnaît explicitement le droit des femmes rurales à la mobilité économique.
La pertinence scientifique, économique et sociologique de la mobilité circulaire des travailleuses rurales se mesure d’abord à la convergence observée entre trois agendas mondiaux
: la modernisation des chaînes agro-exportatrices, la réduction des inégalités de genre et la sécurisation des régimes alimentaires face au choc climatique. En effet, plusieurs travaux empiriques démontrent que les programmes de mobilité temporaire améliorent directement l’autonomisation individuelle des populations concernées, en accroissant leur liberté et autonomisation financière.
Approche méthodologique
Aborder la mobilité saisonnière féminine à Larache suppose de dépasser les lectures strictement descriptives pour élaborer un dispositif méthodologique capable de relier l’expérience micro-sociale des travailleuses aux configurations macro-territoriales qui en déterminent les contours. Ce premier élément expose l’architecture épistémologique de l’enquête. Premièrement, il revient sur la problématique – comment la gouvernance territoriale module-t-elle les parcours migratoires féminins et, inversement, comment ces parcours rétro-agissent-ils sur le développement local, sur les femmes et leurs communautés ?
– pour justifier un raisonnement abductif ancré dans l’approche interprétative. Deuxièmement, il décline les hypothèses opérationnelles dans un modèle circulaire à double boucle : pression agro- climatique et filet de sécurité migratoire d’une part ; gouvernance inclusive et le capital social d’autre part.
Le déclenchement de cette analyse expose le noyau rationnel de l’enquête : comprendre comment le territoire de Larache, pris en étau entre conditions agro-climatique et opportunités agro- exportatrices, façonne la décision migratoire féminine et, réciproquement, comment les transferts économiques et symboliques des saisonnières redessinent la trame locale de développement.
Dès lors que l’objectif consiste à saisir un phénomène situé, l’étude de cas unique s’est imposée ; néanmoins, elle est enrichie par trois sous-unités analytiques afin de rendre compte des dynamiques multi-scalaires : (i) les quartiers d’accueil où s’observe la réinsertion urbaine des travailleuses ; (ii) deux bassins ruraux sources (Ksar El Kébir, Zouada) qui fournissent la main-d’œuvre ; (iii) l’antenne locale du programme de mobilité GECCO, véritable interface entre mobilité circulaire et gouvernance territoriale.
Eu égard à ces choix, l’échantillon comprend quarante entretiens semi-directifs (trente-deux travailleuses, huit acteurs institutionnels) et quatre focus groups, tandis qu’une observation participante a été conduite au sein de deux exploitations fraisicoles du Loukkos. Cette triangulation produit un corpus riche, répartis en vingt-huit nœuds thématiques. De plus, la cartographie participative du port de Larache endosse une fonction heuristique : elle visualise les zones de rassemblement et les temporalités d’embarquement, révélant ainsi la façon dont l’espace logistique perpétue des rapports genrés de pouvoir.
Résultats :
Le premier acquis de cette analyse confirme que la pression agro-climatique déclenche effectivement la décision migratoire et que, dans les zones dotées de mécanisme intermédiaires cellules d’écoute et d’accompagnement ou de coopératives actives, la réduction des risques accroît le capital social et génère un plaidoyer féminin tangible avec un investissement territorial visible sur les femmes et leurs communautés territoriales.
Deuxième apport : la révélation d’un gradient d’empowerment corrélé à la densité des réseaux participatifs. Les zones disposant de cellules d’écoute enregistrent une baisse de 15
% du travail non déclaré et une augmentation significative du vocabulaire d’action (« revendiquer », « planifier », « investir ») et développe la conscience individuelle et collective.
En revanche, l’analyse met également au jour deux limites structurelles. Premièrement, la dépendance financière peut, dans certains ménages, se muer en trappe migratoire : l’amélioration du logement ou le financement des études des enfants et d’accès à la santé, bien qu’indéniables, sont conditionnés à la prochaine campagne espagnole, ce qui perpétue la vulnérabilité face aux aléas du marché européen.
Deuxièmement, la portabilité des droits sociaux demeure incomplète : les acquis sociaux ne sont pas capitalisés et ne sont pas reconnus par la CNSS et les certificats de compétences acquis peinent à trouver équivalence dans le système de formation professionnelle marocain. Ces carences nuancent les résultats et rappellent que l’alignement normatif doit s’accompagner d’accords bilatéraux effectifs sur capitalisation des périodes de cotisation et la certification des acquis.
Mots clés :
Mobilité circulaire ; gouvernance participative ; capital social ; changements climatiques ; empowerment féminin, et développement territoriale local.
Abstract
This thesis analys focuses on the study of the implications and risks associated with the circular mobility of female agricultural workers who leave their local area to work in Spain. The concept of mobility is not widely discussed. Although there are reports and studies that have addressed the subject, there is a lack of in-depth research on the topic, particularly regarding the socio-economic impact of this mobility experience on an international scale and the cause-and-effect relationship between the socio-economic fulfilment of female workers and their “empowerment”. This dimension has been little explored, hence the interest of this research, which aims primarily to
explore this dimension and the strengthening of their ‘empowerment’ in contributing to the socio-economic and environmental development of their community. This research aims to fill this gap by carefully examining the links between the different variables.
This study examines how the seasonal mobility of female agricultural workers in Larache, driven by agro-climatic pressures and European horticultural demand, serves as both an economic safety net and a potential lever for local territorial development. Based on an interpretative paradigm, the study combines a history of migration policies, an analysis of international regulatory frameworks and an immersive qualitative survey. It demonstrates that dependence on remittances intensifies as environmental and public policy indicators deteriorate, but that inclusive and innovative governance (such as correlation entities, listening and support entities: associations, cooperatives, councils, trade unions, multi-stakeholder committees) can convert social capital into bargaining power and a real lever for change, reduce undeclared work and open up entrepreneurial pathways for women. The partial compliance of the programms with international human rights standards improves contractual protection without guaranteeing full portability of rights, hence the proposal for three levers: a territorial information system, a city-countryside charter and integrated multi-stakeholder entities for women's mobility. These results highlight the challenge of multi-level and multi-stakeholder governance capable of articulating resilience, social justice and socio-economic sustainability in the Loukkos plain in northern Morocco.
Keywords
Circular mobility; participatory governance; social capital; climate change; female empowerment, and local territorial development.
Téléchargements
Publiée
Comment citer
Numéro
Rubrique
Licence
(c) Tous droits réservés African Scientific Journal 2025

Ce travail est disponible sous licence Creative Commons Attribution - Pas d'Utilisation Commerciale - Pas de Modification 4.0 International.